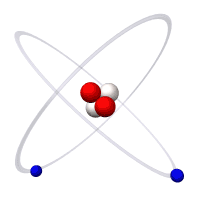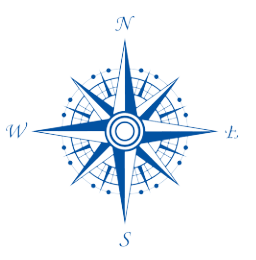INTRODUCTION
LA VISEE D'UN TRAVAIL DE REHABILITATION VOCALE
Les patients dysphoniques présentent une désorganisation du " geste " vocal. Qu’il s’agisse d’une dysphonie avec ou sans lésion des cordes vocales. Dans tous les cas, le but est de favoriser une coordination plus harmonieuse, plus physiologique de l’ensemble des parties du corps qui sont impliquées dans la production de la voix.
La voix est qui concerne le corps dans son entier comme tous les aspects de notre identité et de notre vie de relation. Cette complexité est difficilement compatible avec une approche qui ne viserait qu’à obtenir des changements volontaires. En effet, à tous les étages du fonctionnement de l’appareil vocal, à moins d’avoir déjà pratiqué des explorations sensorielles approfondies, nous ne sommes pas spontanément équipés pour sentir tous les mouvements liés au fonctionnement de l’appareil vocal et en maîtriser volontairement la coordination.
Un travail de réhabilitation vocale implique d’agir sur les trois niveaux de sa production :
- le moteur, la respiration : la fourniture de l’énergie
- le vibrateur, le larynx : la transformation du souffle en ondes acoustiques
- la caisse de résonance : le conduit vocal, qui comprend le pharynx, l’arrière gorge, le voile du palais, les cavités nasales, et l’ensemble de la bouche, au sein duquel les différentes mobilités musculaires viennent façonner le son comme timbre, renforcement des harmoniques du son.
Une dynamique globale aux frontières de la conscience de veille
À tous les niveaux de production de la voix, il y a à la fois du neuro-végétatif, du préconscient et du possiblement conscient. À tous ces étages, la représentation somesthésique [1] est très inégale [2].
Aussi, quand les problèmes vocaux surviennent, le « tout venant » est incapable d’analyser les mécanismes défaillants au niveau de l’appareil phonatoire. La réponse est alors quasiment la même pour tous les « non-initiés » : la fonction sphinctérienne du larynx reprend ses droits, celle de la déglutition, des efforts à glotte fermée, on serre, on force, on pousse en mettant plus de pression sous le larynx pour tenter d’améliorer l’accolement des cordes vocales … un cercle vicieux qui peut conduire à la lésion.
Le fonctionnement laryngé présente des particularités assez inédites et singulières du corps humain :
- Le larynx est un organe en suspension et cette suspension souple doit être maintenue.
- Il possède une commande neuronale très courte et très rapide. Le fonctionnement neuromusculaire du larynx serait en cela assez proche de celui des yeux. Il s’agit donc d’une activité beaucoup plus subtile que celle, même déjà très élaborée, de la coordination de nos gestes.
- Le larynx est le lieu d’un carrefour de fonctions avec des régimes musculaires qui peuvent entrer en conflit les uns avec les autres. C’est un peu comme s’il fallait faire coexister en toute harmonie :
- Un militaire : la fonction de déglutition, la plus archaïque ; un régime musculaire ultra tonique, nécessairement puissant et ultra rapide parce qu’il doit protéger les fonctions vitales, empêcher que toute matière autre que l’air entre dans l’appareil respiratoire.
- Un danseur : la phonation, la plus tardive et élaborée ; un régime musculaire qui réclame une coordination très précise, très sophistiquée, qui donne à chacun une identité vocale unique, qui sert les fonctions corticales les plus élaborées : le langage, l’expression de la pensée, le chant, une forme d’expression artistique.
- Un moine zen : la respiration, le régime musculaire le plus serein, le plus économe, celui de l’immanence, qui marque les frontières de la vie, depuis notre première inspiration jusqu’à notre dernier souffle.
A tous les étages, les dynamiques tensionnelles peuvent être inscrites très profondément dans notre système nerveux et les verrous y être plus ou moins " indéboulonnables "[3] si on tente de les lever par les moyens de la volonté, de l’effort, de la correction, de la rééducation.
L'INTERET DE L'HYPNOSE
Dans ce contexte, l’hypnose s’avère une voie royale pour aller débusquer et initier du mouvement dans des modes d’organisation psycho-corporels qui se seraient figés.
Cela est rendu possible par plusieurs de ses caractéristiques :
- Par le lieu frontalier des états de conscience, dans lequel elle propose qu’on se plonge.
Or c’est dans ces interactions frontalières que se joue la dynamique vocale.
- Par le désengagement des tendances à juger auquel elle invite. Ce principe est particulièrement intéressant pour les dysphoniques, qui sont souvent « englués » dans les jugements de valeur qu’ils portent sur leur voix.
- Par son corollaire, le lâcher-prise. Il est indispensable car le réflexe de la majorité des dysphoniques est de faire des efforts, de passer en force, pour se faire entendre.
- Par l’ouverture maximale du champ attentionnel qu’elle requiert. On propose de porter son attention sur l’ensemble de l’expérience personnelle de l’instant. Autrement dit, tout ce qui est présent à l’esprit, minute après minute, seconde après seconde : perception du rythme respiratoire, des sensations corporelles, de ce que l’on voit et entend, des sensations du goût, de l’odorat, de l’état émotionnel, des pensées qui vont et viennent. Alors les sens, comme les mouvements émotionnels, attentionnels, cognitifs, ne sont plus seulement dévolus à leur rôle d’adaptation au réel mais sont investis pour eux-mêmes et rendus ainsi disponibles pour d’autres organisations, d’autres chemins.
PLUSIEURS AXES D'UTILISATION DE L'HYPNOSE DANS LE TRAVAIL VOCAL
BIBLIOGRAPHIE
CELESTIN-LHOPITEAU Isabelle (sous la direction de). Soigner par les pratiques Psycho Corporelles. Dunod, Paris, 2015.
HEINRICH BERNARDONI (dirigé par). La voix chantée entre sciences et pratiques. de boeck & solal, Paris, 2014.
ROUSTANG François. Qu’est-ce que l’hypnose ? Les Editions de Minuit, Paris, 2003 (1994 pour la première édition).
TITZE Ingo R. Principles of voice production. Allyn & Bacon, 1994
ARNOUX-SINDT Brigitte. Travail publié par la Société française de Phoniatrie et des Pathologies de la Communication SFPPC avec la collaboration d’Edouard Collot, Psychiatre, Directeur scientifique de l’IFH (Institut Français d’ Hypnose), Président GEAMH (Groupe d’Etudes de l’Application Médicale de l’Hypnose) Paris, et de Serge Lorenzo, chef du service de Réadaptation Fonctionnelle à la Clinique mutualiste, responsable du D.U de toxine botulique, praticien hospitalier en ORL et neurologie pour la toxine botulique, Montpellier.
GILDSTON P1, GILDSTON H.. Hypnotherapeutic intervention for voice disorders related to recurring juvenile laryngeal papillomatosis. Int J Clin Exp Hypn. 1992 Apr;40(2):74-87
MACFARLANE FK1, DUCKWORTH M. The use of hypnosis in speech therapy: a questionnaire study. Br J Disord Commun. 1990 Aug; 25(2):227-46.
____________________________________
[1] La somesthésie désigne l’ensemble des sensations qui proviennent des différentes régions du corps. Ces sensations sont élaborées à partir des informations fournies par de nombreux récepteurs sensitifs du système somatosensoriel, situés dans les tissus de l'organisme. La somesthésie est le principal système sensoriel de l'organisme humain.
[2] Celle du diaphragme, le principal muscle de la respiration, qui fournit l’énergie transformable en ondes acoustiques, comme celle du larynx, sont spontanément peu développées dans le cortex. Le larynx y occupe une minuscule zone, entre la langue et le pharynx. Nos perceptions du mouvement et de l’accolement des cordes vocales, du niveau de contraction des muscles laryngés, sont quasiment inexistantes si elles ne sont pas spécifiquement développées.
[3] Les intercostaux, les abdominaux, la région scapulaire, la nuque, la mâchoire dans ses mouvements les plus grossiers, l’apex de la langue sont relativement bien équipés d’un point de vue somesthésique mais il n’en va pas de même pour le diaphragme, pour les mouvements plus fins de la nuque, de la mâchoire, pour la base de la langue et pour toutes les attaches du larynx. Or, le diaphragme, la nuque, la mâchoire et la base de la langue sont des verrous majeurs de la voix. Cette région est souvent un lieu de convergence des tensions du corps entier.
[4] Cette partie, source de nombreux blocages de la voix, est beaucoup plus difficilement accessible à la conscience que la pointe de la langue car, bien qu’unifiées dans un même organe, elles ont deux innervations différentes, la base de la langue étant plus reliée au système viscéral.
[5] Cela se fait dans la suite du travail qu’a proposé Ernest Lawrence Rossi, un des plus proches collaborateurs de Milton Errickson par des soins en hypnose s’étayant sur les possibilités sensorielles et motrices de la main, dont la représentation somesthésique est bien plus importante que celle de la région laryngée.